/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F16%2F34%2F18365833.jpg)
Je ne peux pas ne pas revenir sur mon Ode à la bête, malgré toutes mes bonnes résolutions. Car je suis restée sur ma faim en traitant du premier Alien, contrainte de laisser de côté sa nombreuse descendance et frustrée de ne pouvoir dire tout le bien que j’en pense.
C’est donc à Aliens : le retour que je m’attaque aujourd’hui. Le film de James Cameron sort en 1986, soit 7 ans après le chef d’œuvre de Ridley Scott, et dans un contexte cinématographique très différent. La science-fiction est à la mode, en ces années-là. Elle a aussi beaucoup changé, comme si le règne incontesté de La guerre des étoiles sur les écrans n’avait fait qu’accélérer sa mutation. Quand il est question pour lui de prendre la succession de Ridley Scott, J. Cameron est auréolé du succès de son Terminator, un film qui résume à lui seul la vision du réalisateur. Car si Ridley Scott est un remarquable styliste capable de s’adapter à (presque) tous les genres, James Cameron, pour sa part, est un homme d’obsessions. Et il va utiliser de manière assez inattendue l’univers d’Alien pour les incarner à l’écran.
Il part cependant avec un handicap de taille. La matière formelle du premier film (destiné à l’époque à n’être qu’un « tir isolé ») ne lui permet pas de jouer sur le même terrain, à savoir celui de l’angoisse pure. C’est pourquoi sans doute l’alien de Ridley Scott devient dans la vision de J. Cameron aliens au pluriel, c’est-à-dire la peur induite non plus par la menace dissimulée et inconnue, mais par la multitude. Il ne s’agit pas pour autant d’une trahison. Il s’agit de déplacer le combat sur un terrain que Cameron est sûr de maîtriser, et qui lui permettra de développer à son tour ses propres fantasmes. La question qui m’intéresse est de savoir comment il s’y est pris pour opérer ce glissement thématique sans dénaturer l’héritage du premier film.
Plantons un instant le décor. L’action d’ Aliens : le retour débute très exactement 57 ans après que Ripley ait expédié le monstre dans l’espace. Nous avions laissé l’héroïne en hypersommeil, errant dans le vide avec le mince espoir de voir sa navette de secours atteindre la terre. James Cameron reprend le fil tendu par Ridley Scott en basant sa séquence d’ouverture sur la découverte miraculeuse de la navette, et le sauvetage non moins miraculeux de ses deux occupants (Ripley et son chat). Commence alors un très long prologue qui voit Ripley reprendre pied dans la vie réelle, affronter l’ire de ses employeurs furieux qu’elle ait fait exploser leur cargaison près de 60 ans plus tôt, plonger dans les délices du choc post-traumatique à grands coups de cauchemars, et découvrir enfin que tout ce qui avait constitué son existence a volé depuis longtemps en éclats. Nous apprenons qu’elle avait une fille, et que cette fille est morte pendant son absence. Nous apprenons aussi que la fameuse Compagnie qui l’avait entraînée dans cette histoire n’est guère disposée à reconnaître ses responsabilités. Bref, le retour de Ripley sur terre est bien loin de constituer la « victoire » que nous, naïfs spectateurs, avions imaginé à la conclusion du premier film. A ce propos, il est intéressant de remarquer qu’en réalité, Ripley ne pose pas le pied sur la planète Terre elle-même ; son sauvetage, les soins dont elle bénéficie puis l’espèce de jugement que lui fait subir la Compagnie se déroulent dans les locaux froids et aseptisés d’une station orbitale. La saga toute entière se déroulera d’ailleurs hors de la Terre, faisant de cette dernière l’aboutissement rêvé, le havre peut-être, auquel Ripley aspirera jusqu’au dernier moment. Comme si le danger ne pouvait provenir que de l’étranger, et devait à tout prix être maintenu loin de nos racines (l’ironie étant, bien entendu, que Ripley n’atteindra la Terre qu’une fois devenue elle-même « étrangère »).
L’ouverture de James Cameron reprend donc très précisément chacun des points qui avaient donné son identité à la fois visuelle et thématique au premier film. Elle est lente, presque cérémonieuse, collant au plus près de Ripley et du désastre intérieur que celle-ci doit affronter. C’est sans doute à ce niveau que le réalisateur commence d’ores et déjà à s’approprier Aliens. Du personnage imaginé par Ridley Scott, il retient essentiellement le courage ; mais pour le reste, « sa » Ripley est avant tout un être dévasté qui n’aspire qu’à oublier tout ce qu’il a perdu. Il s’agit alors de la mettre en situation de devoir assumer ses pires craintes. Dans ce but, le scénario joue habilement avec ce qu’Alien, le 8ème passagerla Compagnie, bien sûr) décident alors d’envoyer un petit contingent de marines vérifier ce qui se passe là-bas, et leur représentant, un certain Carter J. Burke, est chargé de convaincre Ripley de les accompagner à titre de conseillère. C’est ainsi que démarre enfin Aliens : le retour. nous avait laissé deviner des pratiques managériales des grandes compagnies du futur pour contraindre Ripley à envisager son retour sur la planète où son équipage a découvert l’Alien. Nous apprenons à cette occasion que ladite planète, nommée Achéron (nous restons dans le symbolisme des noms caractéristiques de la saga), a été transformée en colonie de mineurs dont le travail est d’en rendre l’atmosphère respirable. Et voilà James Cameron débarrassé de l’irritante perspective d’équiper tous ses acteurs de scaphandres. Il va pouvoir se concentrer sur l’action, l’action pure, celle qu’il maîtrise le mieux. Comme par hasard, la colonie d’Achéron a cessé de répondre aux messages radio provenant de la terre. Les autorités (c’est-à-dire
La suite du film constitue, à mes yeux, l’illustration parfaite du talent de James Cameron pour l’action. Je n’ai pas l’intention de résumer ici les événements qui se succèdent à partir du moment où les marines atterrissent sur Achéron, je me contenterai de souligner l’incroyable montée de tension que le spectateur subit au fil de la progression des personnages. Car en tous points, Aliens : le retour prend le contre-pied d’Alien, le 8ème passager. Alors que nous avions dans le premier opus sept personnages ordinaires soudain confrontés à l’inimaginable, James Cameron choisit de mettre en scène un groupe de soldats d’élites prêts à en découdre et sûrs de leur force. L’action en huis clos de l’original s’installe ici a contrario au coeur d’une vaste base courant sur plusieurs niveaux, dont les couloirs semblent sans fin et où le danger peut provenir de n’importe quelle ouverture. Quand il était question chez Ridley Scott de trouver un moyen de sortir d’un espace confiné, il devient chez James Cameron vital au contraire de fermer toutes les issues et de restreindre les zones d’accès. Là où les humains s’organisaient pour mener une chasse au monstre, ici, ce sont les monstres eux-même, multiples et intelligents, qui se transforment en meute et font des marines leur proie. Aliens le retour, double inversé d’Alien le 8ème passager, fait en quelque sorte le récit de son prédécesseur à l’envers. Et il fallait au moins cela pour nous surprendre, car le réalisateur n’oublie jamais que chaque spectateur dans la salle sait ce qui attend les marines inconscients. L’angoisse naît donc de l’accumulation du danger plutôt que de l’attente, du nombre plutôt que de l’unicité. L’Alien est devenu aliens. L’issue du combat n’en apparaît que plus incertaine pour les héros. Acculés et désespérés, ils en sont réduits à faire confiance à l'unique survivante de la colonie, une petite fille surnommée Newt qui semble avoir trouvé le moyen d’échapper aux monstres. Et c’est alors seulement qu’éclate le véritable dessein de James Cameron : montrer au grand jour le combat des espèces.
Mais pas n’importe quelle espèce, bien sûr. Car chez J. Cameron, l’espèce est avant tout une femme, une femme de préférence brisée qui reprend son destin en mains, une femme forte, donc, et chargée de sauvegarder à elle seule l’avenir de tout le genre humain. Le combat mythologique du premier Alien avait fait de Ripley une héroïne quasi-sanctifiée, opposant la blancheur aseptisée de sa tenue spatiale à la peau sombre et dégoulinante de la Bête immonde. Aliens : le retour s’empare du personnage tel que Ridley Scott l’a laissée, et le met face à son égal, ou plutôt son égale, autrement dit, la mère de tous les aliens. C’est ainsi que s’opère dans le film le glissement déjà lisible dans le titre. C’est ainsi aussi que nous passons du masculin au féminin, et que l’histoire devient tout à coup combat de métal contre griffes, de chair contre chair, d’une mère contre une autre.
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F16%2F34%2F18365835.jpg)
Pour en arriver à un tel affrontement ontologique, le film devra répondre à la seule question laissée en suspens dans le premier opus : d’où viennent les œufs d’Alien ? Et James Cameron d’ajouter alors au bestiaire propre à cet univers une de ses plus belles créations : la reine des aliens. Plus grande, plus rapide, plus dangereuse que tous ses enfants, elle est aussi d’une intelligence bien davantage que simplement humaine. La découverte par Ripley de, comment dire, la chambre d’enfantement de la Reineintimité. La Bête était jusque-là l’inconnue ultime ; elle s’incarne tout à coup de chair et de sang, de bave aussi, infiniment physique et infiniment proche de nous. Toute la dernière partie du film se concentre sur ce dernier point, sur l’horrible découverte que l’instinct maternel de Ripley devra affronter son exact pendant incarné par la créature dantesque qui enfante telle une machine biologique des dizaines de parasites ovipares. Mère contre mère, deux espèces luttent pour leur survie respective. Et le combat filmé par James Cameron devient une ode mythologique à la puissance féminine dans sa nature la plus viscérale. constitue encore pour moi, après plusieurs visions, un véritable choc visuel. Car pour la première fois sans doute, l’alien ne nous est plus représenté dans l’horreur de ce qu’il accomplit sur les êtres humains. Non, ce que nous découvrons alors en même temps que Ripley (et avec la même incrédulité terrifiée), c’est la véritable nature du monstre, sa véritable
Aliens : le retour permet donc à la quadrilogie de franchir une nouvelle étape. Nous sommes passés du monstre irréel et mythique à la prolifération dantesque des aliens sans que ceux-ci ne perdent rien de leur potentiel horrifique, ce qui est somme toute extraordinaire. Plus encore, l’univers de la plus parfaite créature cinématographique jamais conçue s’est enrichie d’une nouvelle figure qui s’inscrit idéalement dans la continuité du mythe. Avec un film bâti de scène en scène en double inversé de son prédécesseur, James Cameron a réussi à surprendre, et à ajouter une nouvelle dimension à l’angoisse, tout en développant ses propres obsessions.
br>
Mais il est un dernier point que je souhaite aborder. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il me semble qu’Aliens : le retour est le seul film de la quadrilogie construit sur l’espoir, voire sur l’optimisme. Présenter ce film comme le portrait d’une famille en cours de (re)constitution est sans doute une extrapolation abusive des intentions du scénario. Cependant, lorsque l’on regarde le film dans le contexte des quatre opus, il apparaît indéniablement que ce chapitre-là reste le plus positif de toute la saga. Là où le premier long-métrage faisait le vide parmi ses personnages pour permettre l’éclosion finale d’une héroïne inattendue, Aliens : le retour prend le parti de donner à cette même héroïne une parenté tout à fait surprenante, constituée pour l’essentiel de marines désemparés mais aussi et surtout d’une petite fille qui devient l’enjeu ultime du combat pour la survie. Nous sommes là en terrain plus que familier pour James Cameron, dont la plupart des films mettent en scène un petit groupe résistant au mal, quel que soit l’aspect de ce mal. Mais la conclusion ultime du film est bel et bien que Ripley, et par là-même, l’humanité, a gagné. Qu’elle a conquis le droit de survivre et de rebâtir. Une telle fin n’appelait alors, dans le déroulement de la saga et avec toutes les figures imposées qui la caractérisent, que l’explosion de l’illusion. Et pour schématiser, le troisième film sera chargé de dynamiter par le pire l’optimisme que James Cameron avait voulu insuffler dans l’univers d’Alien. C'est peut-être même la seule véritable raison de son existence au sein de la quadrilogie.
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F16%2F34%2F18892911.jpg)



/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F65%2F68%2F94%2F18957467.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F65%2F68%2F94%2F18927159.jpg)

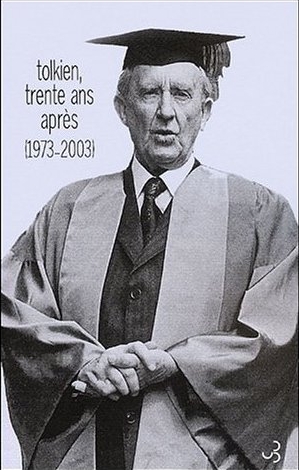
/http%3A%2F%2Fwww.renneslechateau.com%2Flibrairie%2Fods%2Fbergier.jpg)
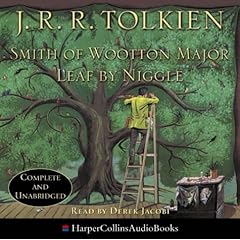
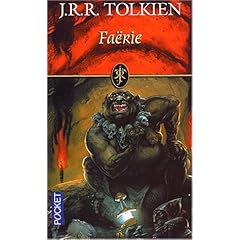
/http%3A%2F%2Fwww.bragelonne.fr%2Fimages%2Flivre%2F20080425procesphoto.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.bedetheque.com%2FCouvertures%2Fsanctuaire01c.jpg)
/http%3A%2F%2Fwww.bdtheque.com%2Frepupload%2FG%2FG_138_2.jpg)

/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F62%2F89%2F45%2F18876909.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F62%2F89%2F45%2F18920642.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F62%2F89%2F45%2F18920659.jpg)

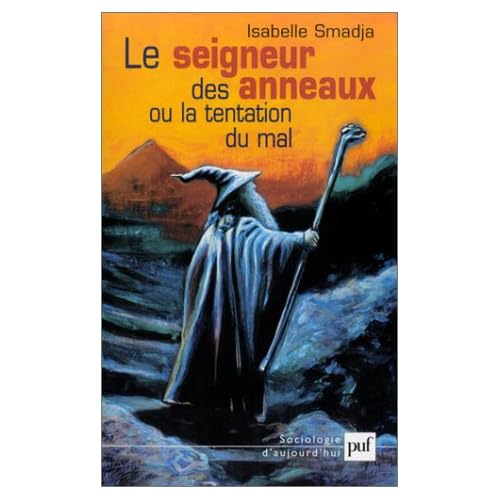
/http%3A%2F%2Ftk.files.storage.msn.com%2Fx1pbglk-vqL4Bv7qRBD0XggfKMkEtSulXWzjDIrPTKIlRWZN_zC77bCI2jrpbfRyUou6qc-9ajPAGNJxCYQxLsYGmJhKojFL1DlY_khpF6-pqtq-siOu8wK5VvbjuQea7WhdbXlEnTalBxZndSgN5DY_khsjrajTJqx)
/http%3A%2F%2Fimg-fan.theonering.net%2Frolozo%2Fimages%2Fedelfeldt%2Fgollum.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F14%2F60%2F18363837.jpg)
/http%3A%2F%2Fa69.g.akamai.net%2Fn%2F69%2F10688%2Fv1%2Fimg5.allocine.fr%2Facmedia%2Frsz%2F434%2Fx%2Fx%2Fx%2Fmedias%2Fnmedia%2F18%2F35%2F14%2F60%2F18892810.jpg)
/image%2F1014460%2F20240410%2Fob_0568de_9782226481474-j.jpg%3Fitok%3DOcvnKcTJ)
/image%2F1014460%2F20240402%2Fob_d074e3_9782253937012-001-t.jpeg%3Fitok%3DGFvSaCRV)
/image%2F1014460%2F20240328%2Fob_3398d5_8adca156c274816e9d0b9c2570577a033fe638.jpg)
/image%2F1014460%2F20240304%2Fob_475fa9_5168199.jpg)
/image%2F1014460%2F20240223%2Fob_3b2950_m02841726371-large.jpg)
/image%2F1014460%2F20240216%2Fob_094bcc_3764699.jpg)